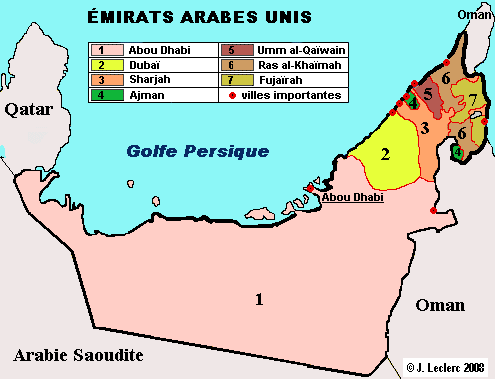![[Émirats arabes unis]](images/Emirats_arabes-drap.gif) Les �mirats arabes unis
Les �mirats arabes unis |
�mirats arabes unis
Al Imarat al � Arabiyah al
Muttahidah
|
Capitale:
Abou Dhabi
Population: 2,4 millions (2003)
Langue officielle: arabe classique
Groupe majoritaire: aucun
Groupes minoritaires: arabe du Golfe (37,4
%), malayalam (11,4 %), t�lougou (4,9 %), baloutchi (4 %), pashtou de l'Est (4
%), arabe hijazi (3,9 %), bengali (3,5 %), arabe omanais (3,2 %), farsi
de l'Ouest (3,2 %), filipino (3,2 %), arabe �gyptien (3,1 %), arabe
leventin du Sud (2,7 %), arabe leventin du Sud (2,6 %), pendjabi de
l'Est (2,1 %), pachtou du Sud (1,5 %), arabe leventin du Nord (1,3 %),
cinghalais (1,3 %), sindhi (1,1 %), arabe standard (1,1 %), somali (1
%), arabe soudanais (0,8 %), arabe taizzi-adeni (0,6 %), arabe libyen
(0,4 %), arabe m�sopotamien (0,3 %), anglais (0,2 %), etc.
Syst�me politique:
f�d�ration de sept �mirats (Abou Dabi, Ajman, Charjah, Doubai, Fuja�rah, Ras el Kha�mah et Oumm al Qa�wa�n).
Articles constitutionnels (langue):
art. 6 et 7 de la
Constitution du
2 d�cembre 1971
Lois linguistiques:
Charte
de la langue arabe |
1 Situation g�n�rale
 |
Les �mirats arabes unis forment une
f�d�ration de sept
�mirats situ�e sur la c�te orientale de la p�ninsule Arabique; ces �mirats
sont Abou Dhabi, Duba�, Sharjah, Ajman, Umm al-Qa�wain, Fuja�rah et Ras
al-Kha�mah (voir la carte). Le territoire des �mirats est d�limit� au nord par le Qatar et
le golfe Persique, � l'est par le golfe d'Oman et l'�tat du m�me nom, au
sud et � l'ouest par l'Arabie saoudite.
La superficie des �mirats arabes
unis est de 83 600 km� (ou l'�quivalant de l'Autriche; France:
547 030 km�). Les sept �mirats sont Abou Dabi (Abu Dhabi), Ajman, Charjah
(Sharjah), Doubai (Duba�), Fuja�rah, Ras el Kha�mah et Oumm al Qa�wa�n (Um
al Kwain). Les �mirats arabes unis font partie de la
Ligue arabe. |
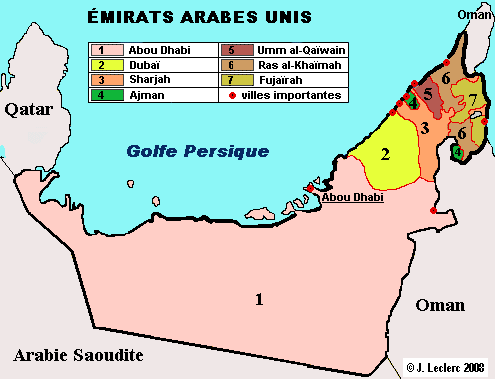 |
Les �mirats se r�partissent in�galement suivant les �tats : Abou Dhabi, avec 67
600 km�, est cinq fois plus �tendu que les six autres �mirats r�unis.
Duba�, le deuxi�me �mirat en taille, ne compte que 3840 km�, tandis que le
plus petit, Ajman, ne s'�tend que sur 250 km�. De plus, l'�mirat de
Sharjah, d'Ajman, de Ras al-Kha�mah et de Fuja�rah sont territorialement
fragment�s.
La ville d'Abou Dhabi,
capitale des �mirats avec 500 000 habitants, abrite le gouvernement f�d�ral et
met en �uvre la politique ext�rieure, la d�fense et l'enseignement des
sept �mirats.
C'est la seule
f�d�ration du monde arabe. Chaque �mirat
est gouvern� par un �mir dont le pouvoir est h�r�ditaire et absolu. Les sept
�mirs forment le Conseil supr�me, qui constitue la plus haute instance du
gouvernement f�d�ral. Le Conseil proc�de � l'�lection d'un pr�sident et d'un
vice-pr�sident parmi ses membres.
Les �mirats arabes unis constituent l'une des
zones les plus riches du monde, poss�dant le plus haut revenu par habitant. Leur
�conomie repose tout enti�re sur l'exploitation des hydrocarbures. |
Dans certains milieux journalistiques, on utilise parfois
la forme abr�g�e �les �mirats� (avec une minuscule initiale). Dans ce cas, la d�nomination sert � d�signer
l'ensemble des �tats de la p�ninsule Arabique: les �AU, mais aussi le Kowe�t, le Qatar, Bahre�n
et m�me le sultanat d'Oman.
2
Donn�es d�molinguistiques
La population de la f�d�ration �tait estim�e en 2003 � 2
445 651 habitants. Les �miriens sont concentr�s dans les villes c�ti�res ou dans
les oasis � l'int�rieur des terres. Les �mirats arabes unis rassemblent une
population assez h�t�roclite en raison du grand nombre de travailleurs
�trangers, � un point tel que les populations indig�nes (les
�natifs�:
Arabes du Golfe, Arabes
b�douins et Arabes shihh) ont �t� minoris�es par les Indo-Pakistanais et les
Indo-Iraniens; elles ne repr�sentent plus aujourd'hui que 37,6 % de la
population totale. Les �trangers sont
attir�s par le haut niveau des salaires offerts dans les
�mirats. Seuls les �natifs� peuvent obtenir la nationalit� du pays.
2.1 Les ethnies
Moins de 60 % des habitants sont maintenant des Arabes de
toutes origines, contre 24,2 % d'Indo-Pakistanais, 11 % d'Indo-Iraniens, 0,8 %
d'Occidentaux (incluant les Europ�ens, les Am�ricains et les Canadiens) et 4,7 % d'Africains, de Philippins, de
Malais, de Japonais, de Turcs et de Chinois.
Arabes
(57,2 %) |
Indo-Pakistanais
(24,2 %) |
Indo-Iraniens
(11 %) |
Europ�ens
(0, 8 %) |
Autres
(4,7 %) |
Arabes du Golfe,
Arabes b�douins
Arabes shihh
Arabes saoudiens
Arabes omanais
Arabes �gyptiens
Arabes jordaniens
Arabes palestiniens
Arabes libanais
Arabes syriens
Arabes soudanais
Arabes y�m�nites
Tsiganes nawari
Arabes irakiens |
Malayali
T�lougous
Bengladeshis
Pandjabi
Cinghalais
Sindhi
Ourdous
|
Baloutches
Pachtouns
Iraniens |
Am�ricains
Canadiens
Allemands
Hollandais
Italiens
Fran�ais
Norv�gien
Su�dois
Grecs
Polonais
Serbes
Croates
|
Philippins
Somalis
Noirs d'Afrique
Malais
Japonais
Turcs
Chinois
|
Outre les populations natives des �mirats, les travailleurs
arabophones proviennent de l'Arabie Saoudite, d'Oman, d'�gypte, de Jordanie, de
Palestine, du Liban, de Syrie, du Soudan, du Y�men et de l'Irak. Les
Indo-Pakistanais constituent le second groupe en importance (24,7 %) avec les
Malayali et les T�lougous du sud de l'Inde, puis les Bengladeshis (Bangladesh),
les Panjabis (Inde), les Cinghalais (Sri Lanka), les Sindhi (Pakistan) et les Ourdous (Pakistan).
Le troisi�me groupe, celui des Indo-Iraniens, est flou parce qu'il regroupe des
ethnies provenant aussi bien du Pakistan que de l'Afghanistan et de l'Iran, mais
leur point commun est qu'ils sont des Iraniens de culture, non des Indiens. Le
quatri�me groupe concerne les Occidentaux (Europ�ens, Am�ricains et Canadiens): ce sont des
travailleurs hyper-sp�cialis�s dans l'industrie p�trochimique. Les
Nord-Am�ricains (incluant les Canadiens anglophones et francophones) sont
pr�sents en affaires depuis des d�cennies, d'abord dans le domaine du p�trole et
du gaz, puis leurs activit�s se sont �largies pour englober les domaines du
g�nie, de l'architecture, de l'�ducation, des soins m�dicaux ainsi qu'une vaste
gamme de services commerciaux.
Le pays abrite aussi d'autres travailleurs asiatiques,
africains, etc. La population urbaine dans les �mirats repr�sente 85 % de la
population totale. Plus de 95 % de la population est musulmane sunnite de rite
kharijite, le reste de la population �tant chiite; les autres sont chr�tiens.
2.2 Les langues
La langue officielle des �mirats est l'arabe classique,
qui sert aussi de langue v�hiculaire entre tous les arabophones. Toutes les
autres ethnies utilisent plut�t l'anglais comme langue v�hiculaire. Aucune
langue maternelle particuli�re n'est majoritaire dans les �mirats, m�me pas une
vari�t� d'arabe, mais l'ensemble des arabophones constituent une sorte de
majorit� de langue, de culture et de religion. Pr�s de 60 % de la population
parle l'une des nombreuses vari�t�s d'arabe: arabe du Golfe, arabe shihh,
saoudien, omanais, �gyptien, jordanien, palestinien, libanais, syrien,
soudanais, y�m�nite, irakien. Toutes les vari�t�s d'arabe appartiennent su
groupe s�mite de la famille chamito-s�mitique
(ou afro-asiatique).
|
Ethnie |
Langue maternelle |
Affiliation linguistique |
Population |
% |
| Arabes du Golfe |
arabe du Golfe |
langue
s�mitique |
750 000 |
30,6 % |
|
Malayali
|
malayalam |
langue dravidienne |
280 000 |
11,4 % |
|
B�douins
|
arabe du Golfe |
langue s�mitique |
167 000 |
6,8 % |
|
T�lougous
|
t�lougou |
langue dravidienne |
120 000 |
4,9 % |
| Baloutches du Sud |
baloutchi |
langue indo-iranienne |
100 000 |
4,0 % |
|
Pachtouns de l'Est |
pachtou de l'Est |
langue indo-iranienne |
100 000 |
4,0 % |
|
Arabes saoudiens |
arabe hijazi |
langue s�mitique |
97 565 |
3,9 % |
|
Bengali
|
bengali |
langue indo-iranienne |
89 000 |
3,6 % |
|
Arabes omanais |
arabe omanais |
langue s�mitique |
80 000 |
3,2 % |
|
Iraniens (Perses)
|
farsi de l'Ouest |
langue indo-iranienne |
80 000 |
3,2 % |
| Philippins |
filipino (tagalog) |
langue austron�sienne |
80 000 |
3,2 % |
|
Arabes �gyptiens |
arabe �gyptien |
langue s�mitique |
75 000 |
3,0 % |
| Arabes jordaniens |
arabe leventin du Sud |
langue s�mitique |
67 147 |
2,7 % |
|
Arabes palestiniens |
arabe leventin du Sud |
langue s�mitique |
64 393 |
2,6 % |
| Panjabis |
pendjabi de l'Est |
langue indo-iranienne |
53 000 |
2,1 % |
| Pachtouns du Sud
|
pachtou du Sud |
langue indo-iranienne |
38 100 |
1,5 % |
| Arabes libanais |
arabe leventin du Nord |
langue s�mitique |
33 574 |
1,3 % |
|
Cinghalais |
cinghalais |
langue indo-iranienne |
32 000 |
1,3 % |
|
Sindhi
|
sindhi |
langue indo-iranienne |
27 000 |
1,1 % |
| Arabes syriens |
arabe standard
|
langue s�mitique |
26 859 |
1,1 % |
|
Somalis |
somali |
langue s�mitique |
25 000 |
1,0 % |
|
Arabes soudanais |
arabe soudanais
|
langue s�mitique |
19 513 |
0, 8 % |
|
Arabes y�m�nites |
arabe taizzi-adeni |
langue s�mitique |
15 000 |
0, 6 % |
| Am�ricains |
anglais |
langue
germanique |
13 500 |
0,5 % |
|
Tsiganes nawari |
arabe libyen |
langue s�mitique |
12 000 |
0, 4 % |
|
Arabes irakiens |
arabe m�sopotamien |
langue s�mitique |
9 401 |
0, 3 % |
| Canadiens |
anglais |
langue germanique |
6 000 |
0, 2 % |
| Noirs d'Afrique |
swahili |
langue bantoue |
5 300 |
0, 2 % |
|
Malais
|
malais |
langue austron�sienne |
5 300 |
0, 2 % |
|
Ourdous
|
ourdou |
langue indo-iranienne |
5 300 |
0,2 % |
|
Shihuh
|
arabe shihhi |
langue s�mitique |
5 000 |
0,2 % |
| Allemands |
allemand |
langue germanique |
1 300 |
0,0 % |
| Japonais |
japonais |
langue japonaise |
1 300 |
0,0 % |
| Hollandais |
n�erlandais |
langue
germanique |
785 |
0,0 % |
|
Turcs
|
turc |
langue alta�que |
752 |
0,0 % |
| Italiens |
italien |
langue romane |
400 |
0,0 % |
| Fran�ais |
fran�ais |
langue romane |
250 |
0,0 % |
| Norv�gien |
bokm�l |
langue
germanique |
200 |
0,0 % |
|
Su�dois
|
su�dois |
langue
germanique |
113
|
0,0 % |
|
Chinois |
chinois mandarin |
langue sino-tib�taine |
100 |
0,0 % |
|
Grecs |
grec |
langue grecque |
100 |
0,0 % |
|
Polonais |
polonais |
langue slave |
100 |
0,0 % |
|
Serbo-Croates
|
serbo-croate |
langue slave |
100 |
0,0 % |
|
|
|
Les langues dravidiennes sont le malayalam
(11,4 %) et le t�lougou (4,8 %). Les langues indo-iraniennes sont le baloutchi,
bengali, pachtou, le farsi, le cinghalais, le sindhi et l'ourdou. L'hindi et
l'ourdou ne forment en r�alit� qu�une seule et m�me langue, mais l�hindi s��crit
avec l�alphabet d�van�gari et l�ourdou avec l�alphabet arabo-persan. Ce sont des
raisons religieuses et politiques qui ont favoris� cette r�partition: les
Pakistanais sont musulmans et voulaient se distinguer des Indiens � majorit�
hindoue. Les diff�rences entre les deux langues ne sont pas seulement d'ordre
graphique (alphabet devanagari pour l�hindi et alphabet arabo-persan pour
l�ourdou), mais aussi d'ordre culturel. Elles refl�tent des divergences
religieuses et politiques, dans la mesure o� l'ourdou est associ� � l'islam et
l�hindi � l'hindouisme.
On compte
aussi des langues austron�siennes (filipino et malais),
germaniques (anglais,
n�erlandais, allemand, norv�gien, su�dois),
romanes (fran�ais, italien),
slaves
(polonais, serbe, croate), jusqu'� des langues alta�ques (turc),
sino-tib�taines
(chinois), japonaises (japonais) et
bantoues (swahili). Aucune des langues non
arabes n'a une chance quelconque de s'imposer, sauf l'anglais comme langue
v�hiculaire.
3 Br�ves donn�es historiques
D'apr�s les fouilles arch�ologiques, l'histoire de la r�gion
remonterait vers 8000 avant notre �re. Des traces d'occupation ont �t� attest�es
aux environs d'Abou Dhabi, de Ras al-Kha�mah et dans le d�sert pr�s de Al Ain.
Cette r�gion �tait un carrefour commercial important entre la M�sopotamie,
l'Iran, le Dilmun (aujourd'hui le Bahre�n ) et l'Inde. Plus tard, il y eut des
contacts avec les Grecs, puis avec les Romains.
En 632, la population fut convertie � l'islam lors de l'invasion
arabe, puis s'arabisa. Par la suite, son histoire se confond � celle de l'Empire
arabo-musulman, notamment avec les
califats d'Omeyyades de Damas et des Abbasside de Bagdad. Grands explorateurs,
les Arabes de la r�gion sillonn�rent l'oc�an Indien et commerc�rent jusqu'au
Vietnam et en Chine. Mais, entre les XIIIe et
XVIIe si�cles, la r�gion
fut convoit�e par les Perses, les Ottomans et les Portugais, ces derniers
occupant le d�troit d'Ormuz au XVIe si�cle. Portugais et Arabes se firent
des
guerres sanglantes, mais les Arabes r�ussirent � mettre les Portugais en d�route. La r�gion
fut rapidement gouvern�e par des cheikhs qui s'affront�rent pour conserver le
monopole sur la p�che des perles et la piraterie. Les Al Qassimi, une riche
famille de Ras al-Kha�mah, r�ussit � s'affirmer davantage et prit le contr�le de
la r�gion. Ils disposaient d'une puissante flotte d'une soixantaine de grands
vaisseaux qui pouvait d�trousser tous les navires �trangers. Les Britanniques
accus�rent les Al Qassimi de piraterie et se servirent de ce pr�texte pour
prendre la contr�le de la r�gion appel�e �la c�te des Pirates�.
3.1 Le r�gime britannique
 |
� partir de 1820, la �la c�te des Pirates� tomba sous la
gouverne des Britanniques qui cherchaient � prot�ger leur fameuse �route
des Indes�. Ils impos�rent aux Arabes le trait� de la Tr�ve et transform�rent la
r�gion en protectorat britannique, appel� ��tats de la Tr�ve� (en anglais: "Trucial
States"). Ce trait� quasi unilat�ral obligeait les �mirats, ainsi qu'�
Bahre�n, au Qatar et au Kowe�t de n'entretenir aucune relation politique ou
�conomique avec un autre pays que la Grande Bretagne... en �change de sa
protection. Les guerres �tant termin�es, les populations c�ti�res reprirent leur
p�che traditionnelle des perles fines; cette industrie resta florissante
jusqu'en 1930. Ce ne fut qu'au d�but du XXe si�cle
que quelques �coles arabes
furent fond�es par des marchands de perle � Duba�, Abu Dhabi et Sharjah. Les
�coles furent pourvues en personnel par des enseignants �trangers qui
apprirent aux enfants la lecture, l'�criture et des �tudes islamiques, le tout en
arabe classique.
|
Les �mirats entr�rent v�ritablement dans l'histoire des
relations internationales lorsque la question des fronti�res avec leur voisin du
nord, l'Arabie Saoudite, alors sous protection am�ricaine, fut pos�e en 1933. La
d�limitation des fronti�res posait le probl�me de la r�partition des immenses
r�serves p�troli�res progressivement mises � jour. Les crises �conomiques des
ann�es trente forc�rent certaines �coles � fermer, mais quelques-unes ont fini
par rouvrir au d�but des ann�es cinquante. Le premier gisement de p�trole dans
les �mirats fut d�couvert en 1953, � Abou Dhabi. Les sept cheikhs subirent, d'une
part, les pressions des Britanniques les invitant � leur accorder des
concessions, et durent faire face, d'autre part, aux mutations d'une �conomie
traditionnelle essentiellement fond�e sur la culture perli�re, entr�e en crise
au cours des ann�es trente du fait de l'invention par le Japon des perles de
culture. Le gouvernement britannique construisit des �coles � Abou Dhabi, Ras al-Kha�mah
et Khawr Fakkan et m�me une �cole d'agriculture � Ras al-Kha�mah en
1955, puis une �cole technique � Sharjah en 1958.
L'exploitation des concessions p�troli�res d�buta apr�s la
Seconde Guerre mondiale. En 1950, un conseil des �mirats fut cr�� sous les
Britanniques qui c�d�rent le pays en 1968. Durant le r�gime britannique,
l'anglais s'est install� dans l'Administration publique, mais n'atteignit jamais
les populations locales.
3.2 La f�d�ration des �mirats arabes
La f�d�ration des �mirats arabes unis s'est form�e le 2 d�cembre
1971. L'article 7 de la Constitution (encore en vigueur) pr�voyait que l'arabe
�tait la langue officielle de l'Union, mais l'anglais demeura toujours pr�sent
dans la vie �conomique et les m�dias. L'article 17 de la Constitution �nonce que
l'�ducation est fondamentale pour le progr�s de la soci�t� et doit �tre
obligatoire et gratuite au niveau primaire et aux autres niveaux (secondaire et
universitaire. De plus, les uniformes, les livres, l'�quipement et le transport
furent d�clar�s �galement gratuits. Quelques enfants ont fr�quent� les �coles
religieuses appel�es madrassa o� ils ont �t� instruits en arabe classique dans
la lecture du Coran.
Les �mirats exploit�rent les hydrocarbures dont les revenus
augment�rent jusqu'� la moiti� des ann�es quatre-vingt. Les �mirats arabes unis
devinrent l'un des pays les plus riches du monde, mais aussi l'un des plus
convoit�s. Le pays reste � la merci des conflits frontaliers, notamment avec
l'Iran qui, en 1992, a annex� trois �les, situ�es dans le d�troit d'Ormuz,
jusqu'ici co-administr�es avec le Sharjah et, dans une moindre mesure, avec
l'Arabie Saoudite. En 1981, le Conseil de coop�ration du
Golfe (CCG) r�unit l'Arabie Saoudite, Bahre�n, les �mirats arabes unis, le
Kowe�t, Oman et le Qatar, soit 44 % des r�serves mondiales de p�trole. Il
pr�nait la d�fense commune et l'int�gration �conomique de ces pays en une zone
de libre-�change.
En 1996, le chef du gouvernement f�d�ral des �mirats refusa de recevoir
le premier ministre iranien en raison de leur diff�rend, tout en maintenant des
relations �conomiques. Le pays a souvent recherch� la protection d'�tats plus
puissants, dans un cadre r�gional, en int�grant notamment, en 1981, le Conseil
de coop�ration du Golfe, puis en signant des accords de d�fense et de
coop�ration avec des puissances occidentales : la France, qui a vendu 436 chars
Leclerc au gouvernement d'Abou Dhabi en 1993, la Grande-Bretagne (accords de
d�fense du 28 novembre 1996) et les �tats-Unis. � partir de 1997, prenant ses
distances avec les pays occidentaux, le cheikh Zayed, pr�sident de la
F�d�ration, boycottait la Conf�rence �conomique pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord qui se tenait en novembre 1997 et se d�clarait oppos� aux
frappes a�riennes men�es par les �tats-Unis contre l'Irak.
L'importance des pays du Golfe s'explique principalement par
leurs �normes ressources �nerg�tiques : ils d�tiennent 53 % des r�serves
p�troli�res connues du monde et g�n�rent plus du tiers de la production
quotidienne mondiale. L'Arabie Saoudite se classe au premier rang avec des
r�serves de 261 milliards de barils, suivie par les �mirats arabes unis (98
milliards) et le Kowe�t (96,5 milliards). L'exploitation du p�trole exigea aussi
de faire appel � des travailleurs �trangers. Bien que la plupart d'entre eux
proviennent des pays arabophones, d'autres viennent des pays occidentaux et de
certains �tats asiatiques (Inde, Pakistan, Afghanistan, etc.). Les �mirats sont
ainsi devenus un pays multilingue et multiethnique, � dominance arabophone et
islamique.
Le 4 janvier 2010, fut inaugur�e la tour Khalifa de Duba� � en
l'honneur de cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyanedu, le chef de l'�tat de la
f�d�ration des �mirats arabes unis, dont Duba� fait partie �, maintenant le plus
haut gratte-ciel du monde, avec ses 828 m�tres et ses 160 �tages habitables.
Cette tour semble repr�sentative de la mondialisation actuelle. Elle a �t�
construite en sol arabe par une main d'�uvre surtout indienne et pakistanaise, �
partir d'une conception am�ricaine, inspir�e des travaux d'un architecte et
ing�nieur originaire du Bangladesh (Fazlur Khan). Il est difficile de trouver un
monument plus repr�sentatif d'une certaine modernit�.
4
La politique linguistique
Les �mirats arabes unis ont �labor� une politique
linguistique d'arabisation depuis l'accession � l'ind�pendance. L'article 6 de
la Constitution du 2 d�cembre 1971 proclame que l'Union fait partie de la grande
nation arabe � laquelle elle est li�e par la religion, la langue, l'histoire et
un destin commun:
Article 6
L'Union fait partie de la grande nation arabe � laquelle elle est li�e par la
religion, la langue, l'histoire et un destin commun. Le peuple de l'Union est
unique et fait partie de la nation arabe. |
L'article 7 d�clare que l'arabe est la langue officielle:
Article 7
L'islam est la religion officielle de l'Union. La Charia islamique est la
principale source de la l�gislation dans l'Union. La langue officielle de
l'Union est l'arabe. |
4.1 La langue de l'�tat
En r�alit�, les �mirats ont deux langues, l'une pour l'�crit, l'autre pour
l'oral. Si l'arabe classique sert de langue �crite pour l'�tat et les m�dias,
l'arabe du Golfe sert de langue orale pour le gouvernement, l'Administration,
l'arm�e, la police, les affaires, etc. C'est en arabe du Golfe qu'on g�re
l'�tat, mais c'est l'arabe classique qui sert de langue v�hiculaire entre les
populations arabophones. Avec les non-arabophones, c'est l'anglais qui remplace
l'arabe classique.
C'est la population indig�ne des �mirats qui contr�le les
affaires du gouvernement, du Parlement, de la police, etc. C'est pourquoi
l'arabe du Golfe, une langue essentiellement orale, est utilis� partout. La
plupart des fonctionnaires parlent donc l'arabe du Golfe, mais aussi l'arabe
classique lorsque les circonstances l'exigent, parfois l'anglais dans certaines
administrations f�d�rales. C'est en arabe du Golfe qu'on discute des lois
r�dig�es en arabe classique, c'est en arabe du Golfe qu'on commente les
r�glements administratifs offerts en arabe classique. Dans les tribunaux,
l'arabe classique est la langue officielle, mais les accus�s, les t�moins et les
avocats peuvent s'exprimer en arabe du Golfe ou en anglais dans toutes les cours
f�d�rales. Dans les municipalit�s (cours locales), c'est l'arabe avec au besoin
les services d'un interpr�te. Cela dit,
il vaut mieux ne pas avoir de contentieux
avec des citoyens de �mirats (les �locaux�), car la justice du pays risque de ne
pas se montrer totalement impartiale. Les services
gouvernementaux centralis�s sont donc offerts en arabe du Golfe (avec les
locaux), en arabe classique (avec les autres arabophones) et en anglais (avec
les �trangers occidentaux et asiatiques).
4.2 Les langues de l'�ducation
L'�ducation a constitu� une priorit� pour le gouvernement
des �mirats arabes unis. Aujourd'hui, il y a plus de 290 000 enfants �miriens
dans les �coles du gouvernement dans le pays. Chaque village dispose d'une �cole
primaire et les plus grandes villes ont des �coles secondaires.
L'�ducation est gratuite pour tous � tous les niveaux, incluant l'universit�.
Les uniformes scolaires, les manuels, l'�quipement et le transport sont aussi
fournis gratuitement. Les gar�ons et les filles ont un acc�s �gal � l'�ducation,
mais ils doivent fr�quenter des �coles s�par�es. La plupart des enseignants
proviennent des autres pays arabes. Le taux d'analphab�tisme �tait � 77 % en
1980, mais � seulement 76 % en 2000. Il existe aussi un grand r�seau d'�coles
priv�es. Presque 40 % des �l�ves dans les Emirats sont inscrit dans les �coles
priv�es.
Dans les �coles publiques, la langue d'enseignement est
l'arabe classique, et c'est dans cette langue qu'on enseigne dans les �coles
primaires et secondaires. Les langues secondes les plus enseign�es sont
l'anglais, le fran�ais, l'espagnol. Dans les �coles priv�es, les langues
d'enseignement peuvent �tre l'anglais, le fran�ais, l'allemand, l'hindi,
l'ourdou, le malayalam, le farsi, etc. Les Am�ricains ont fond� des �coles o�
ils dispensent en enseignement en anglais pour les enfants anglophones des
�mirats; les Fran�ais en ont �galement. En 1977, les �mirats arabes unis ont
fond� une universit� nationale (l'Universit� des �mirats arabes) qui a �t�
model�e d'apr�s le syst�me am�ricain. Les deux langues d'enseignement sont
l'arabe classique et l'anglais. Cependant, � Duba�, l'Universit� am�ricaine (American
University) ne dispense son enseignement qu'en anglais. Le gouvernement �mirien
encourage les �tudiants � aller � l'universit� (environ 11 %) en leur offrant
des bourses g�n�reuses et des prix en argent lorsqu'ils obtiennent un dipl�me.
Les �tudiants qui veulent poursuivre des �tudes � l'�tranger, surtout aux
�tats-Unis et en Grande-Bretagne, sont financ�s par le gouvernement.
4.3 Les m�dias
La Constitution des �mirats arabes unis garantit en
principe la libert� de la presse, mais le contenu �ditorial et politique des
journaux demeure tr�s contr�l�, surtout pour la presse arabophone; la presse
anglophone jouit de plus de libert�. Les organes de presse �crite,
officiellement des soci�t�s priv�es, sont en r�alit� subventionn�s par les
autorit�s. Une l�gislation de 1988 exige l'enregistrement de toutes les
publications et dresse la liste des sujets autoris�s. Les journalistes
pratiquent l'autocensure d�s qu'il s'agit de politique int�rieure, des familles
r�gnantes dans l'�mirat, de religion ou des relations avec les pays voisins
(surtout l'Arabie Saoudite). Pour sa part, la presse �trang�re est censur�e
avant sa distribution.
Les �mirats arabes unis disposent d'une grande vari�t� de m�dias tant �crits
qu'�lectroniques. Parmi les journaux en arabe, mentionnons les quotidiens Al
Bayan, Al Ittihad, l'Al Khaleej, puis l'Al Shindagah,
l'Al Fajr, l'Al-Wahda, etc. D'autres journaux sont en anglais:
Gulf News (quotidien), Emirates Today (quotidien), Khaleej Times,
Abu Dhabi News, Emirates News, etc.
Les stations de radio sont tr�s nombreuses (une
trentaine). La plupart diffusent en arabe classique et/ou en arabe du Golfe.
Quelques-unes diffusent en anglais, dont FM 92, UAE Radio Dhabi et
Voice of the UAE. La station Umm al Qiwan Radio diffuse en
plusieurs langues, notamment en arabe, en ourdou, en hindi, en anglais et en
fran�ais. Pour sa part, Hum FM diffuse en hindi-ourdou.
En ce qui a trait � la t�l�vision, on trouve des �missions
en arabe classique, en anglais, en fran�ais, en hindi-ourdou, en cinghalais. Le
tableau qui suit pr�sente une r�sum� de la situation pour les cha�nes de
t�l�vision nationales.
|
D�signation des cha�nes nationales |
Statut |
Type de programmation |
Langue de diffusion |
|
UAE-Channel 4 Ajman TV |
priv� |
g�n�raliste |
arabe |
|
EDTV Emirates Dubai TV |
priv� |
information, sport, divertissement
|
arabe et anglais |
|
UAE-TV Sharjah |
priv� |
g�n�raliste |
arabe, ourdou, hindi, anglais et fran�ais
|
|
UAE TV- Abu Dhabi |
public |
g�n�raliste |
arabe (Channel 1), anglais et fran�ais
(Channel 2) |
|
UAE TV- Duba� |
public |
g�n�raliste |
arabe, anglais et fran�ais |
|
UMM AL-Kha�mah Broadcasting |
priv� |
g�n�raliste |
arabe, cinghalais et ourdou |

La politique linguistique des �mirats arabes unis en est une d�unilinguisme
arabe, mais la diglossie arabe dialectal (arabe du Golfe) et arabe classique est
courante. Il n'existe pas, au sens juridique du terme, de minorit�s linguistiques
dans les �mirats, sauf religieuses. Les arabophones doivent parler l'arabe, les
autres l'anglais. La notion de minorit� linguistique n'existe pas parce que les
autres langues sont consid�r�es comme des langues immigrantes, donc
ignor�es, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays du monde. En
fait, les �mirats composent avec un certain bilinguisme arabo-anglais afin de
permettre une meilleure harmonisation entre les nombreux travailleurs �trangers.
Dans les affaires de l'�tat, c'est la valorisation de la langue officielle et le
maintien de l'arabe du Golfe dans les communications informelles. Toutefois,
dans les �coles priv�es et dans les m�dias, c'est la non-intervention et le
multilinguisme qui r�gne, avec une dominance pour l'anglais.
De toute fa�on, les �mirats arabes unis sont r�put�s pour bafouer facilement
les droits humains. Dans ces conditions, la question des groupes minoritaires
d'origine immigrante fait figure de probl�me marginal.

Derni�re mise � jour:
22 d�c. 2023

Bibliographie
KHOURY, Enver. The United Arab Emirates: Its Political System and
Politics, Hyattsville (Maryland), Institute of Middle Eastern and
North African Affairs, 1980.
NIBLOCK, Tim. Social and Economic
Development in the Arab Gulf, Londres, �ditions Croom Helm, 1980.
PECK, Malcolm C. The United Arab
Emirates: A Venture in Unity, Boulder (Colorado), �ditions Westview
Press, 1986.
PETERSON, John E. The Arab Gulf States: Steps Toward Political
Participation, New York, �ditions Praeger, 1988.
THUAL, Fran�ois. Abr�g� de g�opolitique du Golfe,
Paris, �ditions Ellipses, 1997.
|
![[Émirats arabes unis]](images/Emirats_arabes-drap.gif) Les �mirats arabes unis
Les �mirats arabes unis